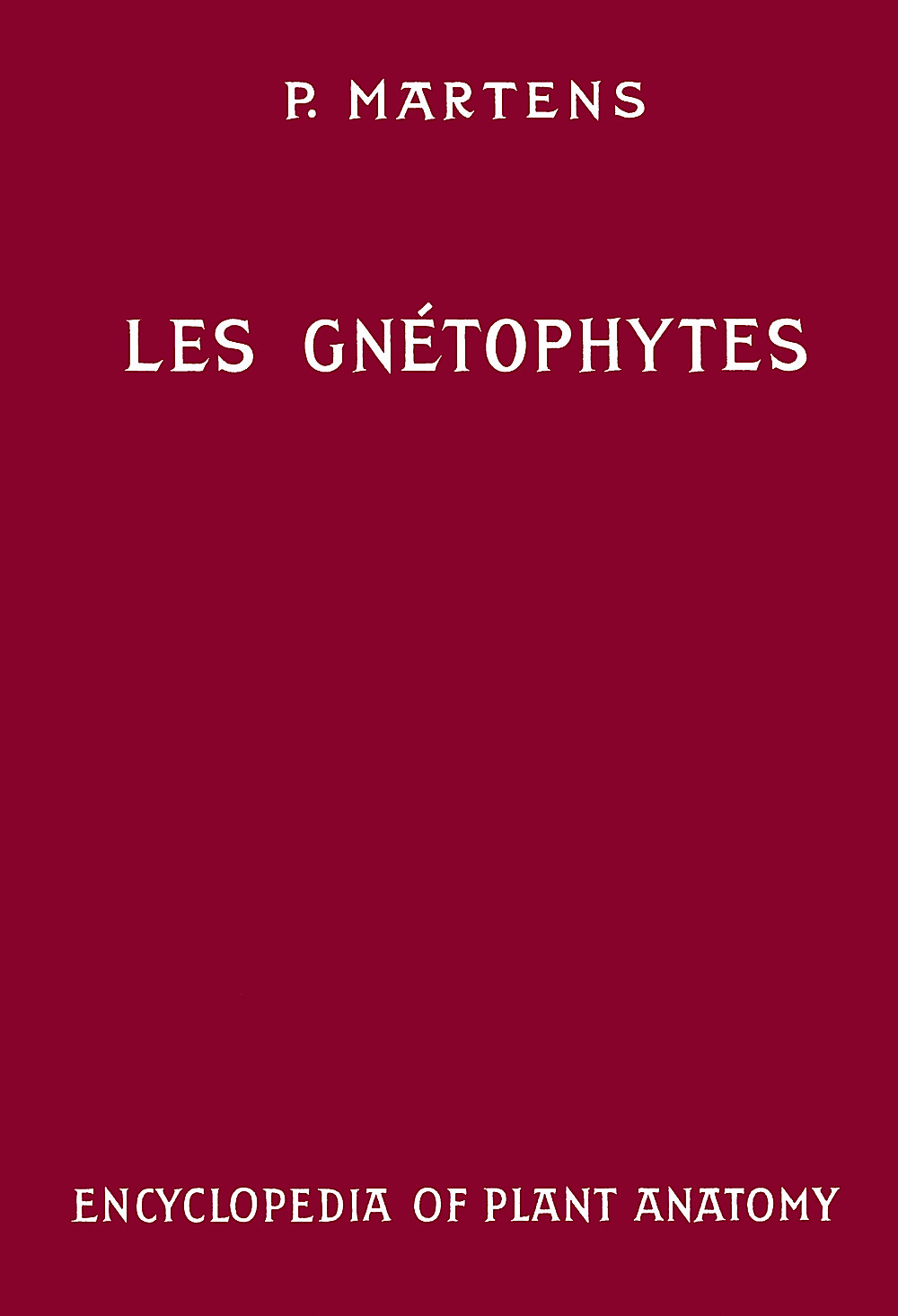Résumé top ↑
Le présent ouvrage tente de synthétiser les données organographiques,
anatomiques, histologiques, cytologiques et ontogénétiques, relatives
aux Gnétophytes, à leur cycle de développement, à leurs affinités et
relations phylétiques. Entrepris en 1966, à la demande du Professeur
W. ZIMMERMANN, il s’appuie largement sur les recherches qu’avec
plusieurs de nos collaborateurs, nous poursuivons, sur ce groupe
passionnant, depuis une quinzaine d’années.
L’importance biologique des Gnétophytes — ou «Gnétales», ou
«Chlamydospermes» — est sans commune mesure avec le nombre d’espèces
identifiées et avec la place qu’elles occupent à la surface du
globe. Elles se limitent à trois genres: Ephedm, Welwitschia et
Gnetum. L’un d’eux est monotype (Welwitschia mirabilis); de chacun des
deux autres, on a dénombré une trentaine d’espèces.
Mais les Gnétophytes se présentent au botaniste, depuis longtemps,
comme un ensemble d’un intérêt exceptionnel et comme une énigme
particulièrement irritante. Elles se placent à la jonction, à la
charnière entre Gymnospermes et Angiospermes. Et chez ses trois
représentants, on découvre de fait, à des degrés divers, un mélange
équivoque de traits dont les uns sont gymno- et les autres
angiospermiques. Mélange qui invitait à voir là un «groupe de
transition» — un «missing» ou «connecting link» —, à y chercher un fil
conducteur propre à éclairer l’énorme et difficile problème de
l’origine des Angiospermes. Mais mélange trompeur, «lure and despair
of the morphologist» écrivait W. Thompson en 1916; car l’espoir de
découvrir ce fil ... ou de le constater résistant fut constamment
contrarié ou déçu.
D’autre part, le rapprochement même des trois genres ne va pas sans
difficultés. Car si les traits communs sont indéniables, les
oppositions ne sont pas moins éclatantes et le poids relatif des uns
et des autres a été abondamment controversé.
L’intérêt mérité par les Gnétophytes dépasse fort, d’ailleurs, celui
de la recherche et de l’évaluation des ressemblances, affinités ou
critères phylétiques. Nombre de traits d’organogenèse, d’histologie,
d’anatomie, de cycle vital, s’y réalisent de façon originale et
instructive. Il en est surtout ainsi chez le Wel'witscbia, un des
«monstres» les plus étonnants du règne végétal, un de ces végétaux
«qui ne peuvent rien faire comme les autres!».